La campagne à la ville : un rêve dans l’air du temps
L’idée de produire et de manger « comme à la campagne » n’est pas nouvelle. Non seulement pour bénéficier d’aliments plus frais mais aussi plus sains et meilleurs pour le bilan carbone de la planète. Les fermes urbaines, ou fermes verticales, en sont l’illustration et leur développement, en particulier aux Etats-Unis, se rapproche de la maturité. Comme il se doit, les techniques de production et de distribution sont les plus high tech possibles.

Il y a quatorze ans, l’idée paraissait encore marginale. Aujourd’hui, elle s’est imposée dans de plusieurs métropoles d’Amérique du Nord, comme une composante crédible de la transition alimentaire. À Montréal, la société pionnière Lufa Farms, qui avait installé en 2011 la première serre commerciale sur un toit d’immeuble à Ahuntsic, cultive désormais plus de 30.000 m² répartis sur quatre sites urbains. Son modèle, fondé sur des abonnements hebdomadaires de paniers de légumes, dessert plus de 25.000 familles chaque semaine, livrées dans près de 600 points de collecte. Les produits sont cueillis le jour-même, garantissant fraîcheur et zéro gaspillage logistique et les techniques de production, basées le plus souvent sur l’hydroponie (nutriments) garantissent la qualité et la régularité d’une production totalement automatisée.
À New York, Gotham Greens, autre pionnier du secteur, exploite plus de dix fermes hydroponiques sur les toits de Brooklyn, Chicago, Denver et même Providence. Leur production, vendue dans les enseignes Whole Foods, Amazon Fresh ou Target, repose sur une culture hors sol contrôlée par intelligence artificielle : température, humidité, CO₂, lumière LED et arrosage sont pilotés à distance pour optimiser les rendements, réduire la consommation d’eau de 95 % par rapport à l’agriculture traditionnelle, et éliminer l’usage de pesticides. En 2023, Gotham Greens a franchi les 100 millions de dollars de chiffre d’affaires.
Un essor international… y compris en France
Au-delà des toits, la culture s’installe désormais à la verticale. À Dubaï, Emirates Crop One a inauguré en 2022 la plus grande ferme verticale du monde, nommée Bustānica. Sur plus de 30.000 m², cette installation entièrement climatisée produit chaque jour 1 tonne de verdures à destination des repas servis sur les vols d’Emirates Airlines. Le site fonctionne en circuit fermé, en recyclant 99 % de l’eau utilisée. À Suwon, en Corée du Sud, Vertical Farm 1 s’élève sur dix étages : conçu comme un bâtiment agricole autonome, il fournit légumes-feuilles et herbes aromatiques aux cantines municipales et aux commerces de proximité, tout en produisant sa propre énergie solaire.
Le Covid-19, puis les crises logistiques et alimentaires exacerbées par la guerre en Ukraine, ont renforcé l’intérêt des villes pour une autonomie alimentaire accrue. Paris a ainsi développé un plan d'agriculture urbaine depuis 2016, avec 100 hectares de toits et murs végétalisés en projet, dont un tiers dédié à la production comestible. Sur le toit du Parc des Expositions de la Porte de Versailles, la plus grande ferme urbaine d’Europe, exploitée par Nature Urbaine, cultive plus de 30 espèces en hydroponie et aéroponie sur 14.000 m².
À Paris toujours, Cycloponics transforme des parkings souterrains et des anciennes stations de métro en champignonnières et microfermes. Ces espaces, souvent inoccupés, offrent des conditions idéales de température et d’humidité. À Bordeaux et Strasbourg, des cultures de pleurotes, endives ou micropousses y prospèrent, distribuées en circuits courts aux restaurateurs et AMAP.
Le modèle des fermes urbaines a évolué vers davantage de sobriété. Après l’échec d’Agricool, qui visait une industrialisation rapide des conteneurs agricoles à Paris, de nouveaux acteurs privilégient des projets locaux à taille humaine. La Ferme Urbaine Lyonnaise, coopérative installée dans le quartier de Gerland, alimente marchés, cantines scolaires et cuisines solidaires tout en formant des jeunes en insertion. À Chicago, The Green Youth Farm propose chaque été à des lycéens de cultiver des potagers en friche, les sensibilisant à l’écologie, à la nutrition et à l’entrepreneuriat.
Un modèle économique encore à prouver
Les débuts du secteur avaient été freinés par la frilosité des investisseurs. Aujourd’hui, les fonds spécialisés en foodtech, comme S2G Ventures (États-Unis) ou Blue Horizon (Suisse), injectent des capitaux massifs dans des start-up comme Plenty (Californie) ou Infarm (Allemagne). Toutefois, la faillite d’Infarm en 2023, victime d’une croissance trop rapide et d’un modèle trop énergivore, rappelle que la technologie ne suffit pas. Les projets résilients combinent innovation, maîtrise des coûts, et ancrage territorial.
Dans sa version ultime, la ferme urbaine pourrait prendre l’allure d’un gratte-ciel multifonction : logements, bureaux, commerces et étages agricoles superposés. Plusieurs projets architecturaux, comme Dragonfly (New York) ou Agrotopia (Belgique), esquissent ces visions. Mais le coût d’investissement reste colossal. Dickson Despommier, pionnier du concept de ferme verticale et auteur de The Vertical Farm, estimait dès 2011 que seuls des financements publics en R&D permettraient d’enclencher le changement d’échelle.
Aujourd’hui, de nombreuses villes ont intégré l’agriculture urbaine dans leur stratégie de résilience. L’ONU promeut les City Food Policies, et les réseaux Milan Urban Food Policy Pact ou RUAF Global Partnership coordonnent ces efforts. Les fermes urbaines, longtemps vues comme anecdotiques, incarnent désormais une réponse concrète et multidimensionnelle : production locale, éducation, emploi, adaptation climatique et réduction de l’empreinte carbone.
Michel Ktitareff
Président de Scale-Up Booster


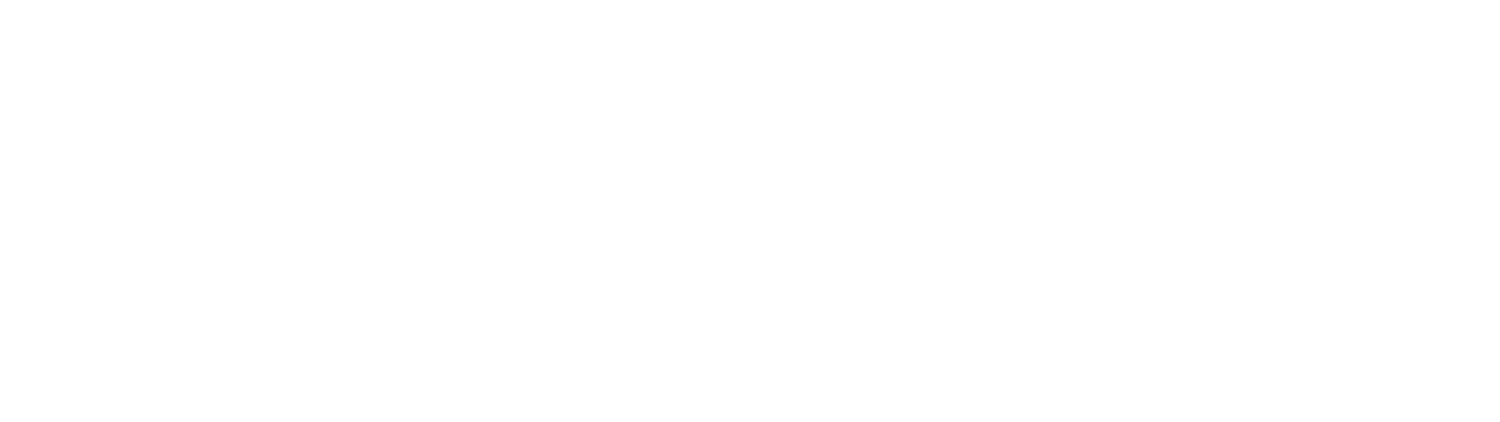 Une solution de communication unique au service des entreprises
Une solution de communication unique au service des entreprises